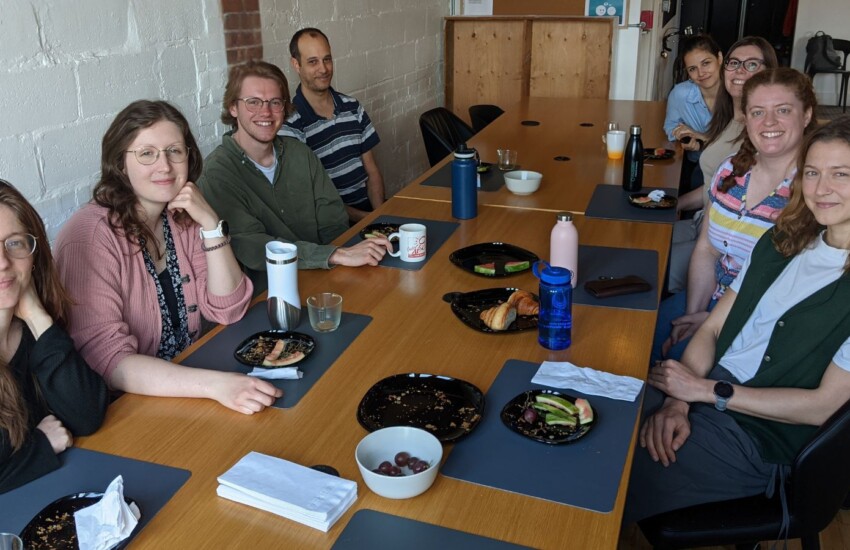Au Québec, la situation du caribou est à la fois critique et emblématique, car elle illustre autant la perte de biodiversité, la destruction des forêts matures, l’importance culturelle de cette espèce pour les peuples autochtones que les interactions complexes entre les juridictions provinciales et fédérales.
De nombreux inventaires et rapports scientifiques ont confirmé l’important déclin de plusieurs populations de caribous au Québec ces dernières années. Malgré certaines mesures mises en place pour la survie et le rétablissement de ces populations, les efforts demeurent largement insuffisants.
Dans un rapport d’août 2022, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, appelait à instaurer des mesures de protection des grands massifs de forêts matures, tel un moratoire, d’ici le dévoilement de la Stratégie de protection et de rétablissement du caribou promise par le gouvernement du Québec.
Durant l’été 2024, alors que la Stratégie du Québec promise depuis 2019 se fait toujours attendre, le gouvernement fédéral a annoncé que la prise d’un décret d’urgence serait envisagée pour protéger certaines populations québécoises de caribou faisant face à une menace imminente. Le décret d’urgence est un mécanisme permettant l’intervention du gouvernement fédéral dans les territoires provinciaux pour la protection des espèces en cas d’urgence, prévu à la Loi sur les espèces en péril.
Notons qu’un régime juridique distinct, découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-est québécois (CNEQ), trouve application dans certaines régions du Québec à l’égard des Cris, des Naskapis et des Inuit. Ce régime complexe ne sera pas abordé ici.
Le caribou et ses différentes populations
Au Canada, on trouve quatre sous-espèces de caribous, appartenant toutes à la même espèce. Au Québec, seule l’une d’entre elles est présente : le caribou des bois. Cette sous-espèce est divisée en trois écotypes: le caribou migrateur, le caribou montagnard et le caribou forestier. Les distinctions entre les écotypes reposent sur des comportements spécifiques, notamment en matière d’habitat et d’alimentation. Le caribou forestier, aussi appelé « caribou boréal », est réparti en petits groupes vivant dans la forêt boréale. Autrefois largement répandu à travers le Québec, le caribou forestier a vu sa population et son aire de distribution décliner fortement au cours des dernières décennies.
La population de caribous des bois de la Gaspésie, communément appelé « caribou de la Gaspésie » appartient à l’écotype montagnard. Elle réside en haute altitude dans le massif gaspésien, surtout dans le parc national de la Gaspésie. Tant au niveau provincial que fédéral, la situation du caribou de la Gaspésie est considérée encore plus précaire que celle des autres populations.
Les causes de son déclin
Plusieurs facteurs contribuent au déclin du caribou : la perte, la fragmentation ou la modification de son habitat, notamment les forêts matures, dues aux perturbations humaines comme les activités forestières et minières, qui ont également entraîné une augmentation des prédateurs, notamment par le loup, l’ours noir et le coyote. De plus, des stresseurs supplémentaires, tels que le récréotourisme, la chasse sportive, les incendies et les épidémies de tordeuses des bourgeons de l’épinette, viennent aggraver la situation.
Outre les deux petites populations de Val-d’Or et Charlevoix mises en enclos dans les dernières années, le caribou forestier vit librement dans la nature. Il peut ainsi circuler sur des terres publiques provinciales et fédérales, dans des parcs nationaux et sur des terres privées.
Cadre juridique provincial
Au Québec, le caribou forestier a été désigné comme espèce vulnérable en 2005 selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV), tandis que le caribou de la Gaspésie a été désigné comme espèce menacée en 2009.
La LEMV vise à prévenir le déclin des espèces fauniques et floristiques (animales et végétales) en leur attribuant un statut de précarité, qui entraîne certaines mesures visant la survie et le rétablissement de ces espèces. Spécifiquement pour les espèces fauniques, il faut aussi consulter la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
La responsabilité de mettre en œuvre la législation québécoise pour la protection des espèces en situation précaire incombe au ministère de l’Environnement. Quand une espèce est officiellement désignée comme menacée ou vulnérable, le ministère responsable peut, sans y être obligé, créer une équipe de rétablissement afin d’établir un plan de rétablissement. Cette équipe est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre ce plan de rétablissement, qui fixe les objectifs, mesures et actions recommandées pour favoriser le rétablissement d’une espèce menacée ou vulnérable.
Pour la caribou forestier, un premier plan de rétablissement a été publié pour la période 2005 à 2012, suivi d’un autre pour la période 2013-2023. Le caribou de la Gaspésie, pour sa part, a fait l’objet de différents plans de rétablissement, dont le dernier date de 2019. Différentes mesures ont également été mises en œuvre comme un moratoire sur les coupes forestières dans l’habitat des caribous de Val-d’Or et comme la mise en enclos de certaines populations, mesure qui a été critiquée par plusieurs acteurs de la société civile. Malgré ces mesures, le déclin de l’espèce continue.
Le gouvernement du Québec promet de publier une stratégie pour les caribous forestiers et montagnards, visant à préserver et restaurer d’importantes portions de leur habitat. L’adoption de cette stratégie, annoncée pour 2019, a été reportée à plusieurs reprises.
En avril 2024, le gouvernement du Québec a lancé une consultation concernant les mesures de conservation pour les caribous forestiers de Charlevoix et montagnards de la Gaspésie, proposant notamment de revoir la définition de son habitat et visant à préciser quelles activités pourront s’y dérouler et dans quelles modalités (activités forestières ou minières, récréotourisme, entretien des lignes électriques, etc.).
Au niveau fédéral
Depuis 2003, le caribou forestier est désigné comme espèce menacée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), alors que le caribou montagnard de la Gaspésie est désigné comme en voie de disparition. Cette loi, appliquée par le ministre fédéral de l’Environnement, vise à prévenir la disparition des espèces sauvages et à permettre le rétablissement de celles qui sont en péril en raison de l’activité humaine.
Alors que le plan de rétablissement est facultatif au niveau provincial, il est obligatoire pour le ministère fédéral d’adopter un Programme de rétablissement. En 2020, le gouvernement fédéral a adopté le plus récent Programme de rétablissement pour le caribou forestier. Il a fait de même en 2022 pour le caribou de Gaspésie. Ces plans d’actions prévoient différentes mesures de nature surtout politique et administrative.
La LEP s’applique principalement aux terres publiques fédérales. Toutefois, en vertu du paragraphe 80(2), le ministre fédéral de l’Environnement doit recommander un décret d’urgence pour protéger une espèce s’il constate que sa survie ou son rétablissement fait face à une menace imminente, même sur des territoires non domaniaux (terres privées, terres publiques provinciales).
En juin 2024, considérant que plusieurs populations de caribou forestiers faisaient face à des menaces imminentes et que le Québec n’avait pas pris les mesures nécessaires pour les protéger, le ministre de l’Environnement fédéral a recommandé au gouvernement un décret d’urgence. Cette recommandation visait les hardes de Pipmuacan, de Val-d’Or et de Charlevoix, et non celle de la Gaspésie. Une consultation a été menée dans les mois suivants pour élaborer le contenu du décret d’urgence.
Les peuples autochtones : acteurs clés de la protection du caribou
Le caribou étant une espèce essentielle à l’identité culturelle de plusieurs communautés et Nations autochtones, le déclin de plusieurs populations est un enjeu les affectant directement.
Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a notamment demandé aux tribunaux de déclarer que le gouvernement du Québec n’avait pas respecté ses obligations constitutionnelles de les consulter lors de l’élaboration de la stratégie de protection du caribou. C’est ce qu’a conclu la Cour supérieure en juin 2024, ordonnant au gouvernement d’entamer un processus distinct de consultation avec la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie sur les caribous forestiers et montagnards.
D’autres organisations et communautés autochtones ont critiqué le manque d’action pour protéger le caribou et l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) a affirmé accueillir favorablement l’intervention fédérale dans l’élaboration d’un décret d’urgence.
Depuis de nombreuses années, plusieurs communautés autochtones ont également été à l’initiative de différentes actions concrètes de protection du caribou, notamment le suivi des populations, la gestion des prédateurs et la restauration des habitats par le démantèlement de chemins forestiers.
La protection et le rétablissement du caribou forestier et de son habitat naturel relèvent donc des compétences partagées des différents niveaux de gouvernement, avec les efforts concertés des peuples autochtones. Différents outils juridiques sont disponibles pour mettre en place une stratégie efficace et durable, en plus du filet de sécurité des décrets à la disposition du fédéral. Leur mise en œuvre efficace et concertée demeure toutefois toujours attendue, reposant largement sur la volonté politique des gouvernements provincial et fédéral. Encore davantage qu’une meilleure application des outils existants, la protection effective des espèces menacées et vulnérables appelle à une réforme du cadre juridique actuel, ce que demandent le CQDE et de nombreux groupes œuvrant à la protection de la biodiversité.
Merci à Janis Leeming, Chloé Blanchet pour leur contribution à cet article.
Attention: Cet article présente le droit en vigueur au Québec et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, vous pouvez consulter un·e avocat·e ou un·e notaire. Pour obtenir de l’information juridique, vous pouvez contacter les juristes du CQDE.
 Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.
Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.